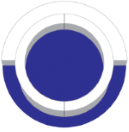2621 - Les promeneurs solitaires
N. Lygeros
Nous marchions, comme à notre habitude, le long d’un chemin de terre, au bord de l’eau. Nous n’entendions que le bruit sur notre petit parapluie qui nous protégeait avec grand peine. Il faisait tous ses efforts mais les baleines supportent la fluidité de l’eau. Nous étions comme dans Alter Ego, seuls mais unis. Nous étions les porteurs de parapluie.
Ce jour-là, la rivière s’était approchée étrangement de la rive. Elle ne flirtait plus avec le rivage, elle débordait comme une caresse sur un visage. Nous sentions tous les deux les mains de l’eau, dans les bras de la rivière qui nous embrassait le plus tendrement possible. Notre petit chemin de terre était devenu une langue dont nous ne connaissions pas le langage. Elle tentait de nous parler par le truchement de la pluie sur la diaphanéité de notre protection de fortune. Aussi nous écoutions le silence de la terre sous nos pieds trempés. Rien ne nous différenciait des arbres si ce n’est notre mobilité. Ils étaient les pieds dans l’eau en vacance d’hommes. Ils étaient en partance immobile. Ils écoutaient les caresses des flots sans bouger, en respirant à peine. Entre la terre et l’eau, nous étions l’humanité du moment qui marchait librement assiégée. Nous marchions sur la tendresse d’une terre aimée et pourtant elle ne nous appartenait pas. Elle était là pour nous comme si nous étions là pour elle. Nous étions tous une rencontre insolite à l’instar de cette pierre arrondie qui appartenait autrefois au rivage. Devenue amer par tendresse, elle signalait présence de la mémoire au sein de l’oubli. Aussi elle nous toucha encore plus ce jour-là.
Nous étions les mêmes mais tout avait changé et tout prenait un nouveau sens. Ce que nous considérions autrefois comme des détails, en disparaissant sous l’eau, étaient devenus des attachements. Cette terre, qui nous était étrangère dans le passé, appartenait désormais à notre passé. En laissant de côté la météorologie, nous découvrîmes le temps. Ce n’était pas encore celui des cerises, mais les aubépines étaient déjà en fleur et leur blancheur tranchait dans le règne végétal de l’hiver. Ainsi sans entendre encore les premières notes du printemps, nous voyions déjà ses couleurs. Nous les trouvions aussi au bord de l’eau qui avait laissé sur l’herbe d’un vert tendre, le mauve et le violet de feuilles tombées à terre. Nous marchions à leur côté sans les toucher, de peur de déranger la gamme chromatique. Les couleurs de notre petit chemin de terre noyé, avait la musicalité du silence de l’eau. Sur le bruit de nos pas nous laissions nos commentaires comme les explorateurs d’une civilisation inconnue. Nous étions géographes, géologues, naturalistes, entomologistes et ornithologues, seulement nous étions avant tout des hommes, des hommes retrouvés dans la nature. Entre l’eau et la terre, nous étions les fils du feu prométhéen, de la lumière humaine, si faible et si puissante
Nous étions des promeneurs solitaires dans un nouveau paysage que nous n’avions jamais dessiné dans le passé. Désormais un peu moins solitaires, nous redessinions l’avenir de cette petite langue de terre dans un langage gorgé d’humanité car depuis ce jour nous savions que tout était possible.