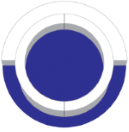1676 - Noir d’encre
N. Lygeros
En relisant l’ouvrage, l’imprimeur humaniste ne put s’empêcher de repenser au Maître avec émotion. Malgré leur savoir, ou peut être en raison de celui-ci, ils étaient tous deux amoureux des bonnes choses de la vie. Immanquablement lui vint à l’esprit un épigramme de son ami. « Parce que les travaux de médecins qui nous ont précédés sont ignorés, je t’envoie la recette du garum. Tu ajoutes à du vinaigre une égale quantité d’huile. Certains trouvent le beurre plus savoureux. Quand tu es resté longtemps courbé sur tes livres, aucune drogue ne réveillera mieux ton appétit émoussé. Aucune n’est un laxatif plus doux, aucune n’est un purgatif plus efficace. Et le plus merveilleux, c’est que lorsque tu auras goûté au garum, aucun condiment douceâtre ne pourra te plaire ». Combien était lointain ce temps de la douceur, il n’osait y songer. Pourtant, ces propres vers lui revinrent en tête et il n’hésita pas un instant à se replonger dans ce parfum d’antan. « Grâce à ton génie, Rabelais, tu nous as rendu le garum des temps antiques. Déjà, dans nos vers, ô Marot, nous avons célébré la délicieuse invitation et la saveur parfumée qu’il apporte tout à la fois au palais et à l’estomac. Non, il ne faut pas cacher un bien si précieux ». Ce dernier vers le ramena à l’ouvrage. Il ne pouvait être modifié sous prétexte que les circonstances accablaient son auteur. En tant qu’imprimeur il avait le devoir de protéger la lettre de l’esprit. Car les affres de celui-ci mettaient en péril la mémoire des maux. Il était médecin mais aucun remède ne pouvait le guérir. L’imprimeur repensa à la phrase de son ami. « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». C’était la pause, ses compagnons n’oubliaient jamais cet instant. Cela leur permettait de discuter du texte qui était sous presse. Il pensa qu’ils ne manqueraient pas de le questionner sur son ami. Mais ils devaient se concentrer pour l’heure car c’était l’unique chose qui lui importait. Ils décidèrent d’aller boire tous ensemble sur les quais de Saône. Ils s’enfoncèrent dans le passage qui débouchait sur le bleu de ses pensées. Ils devaient commenter le texte, analyser son avertissement. Et ils devaient à nouveau choisir entre le monde de Bacchus et celui d’Apollon devant le méchant banquet au bord de l’eau. En quelques mots, souvent bons, ils s’enfonceraient dans l’oeuvre pour ne plus y revenir. Combien cela avait été doux si cela avait été. Les mésaventures du Maître laissait deviner l’épaisseur du voile qui s’abattait sur eux. Boire ou manger n’y changerait rien en fin de compte. Néanmoins, comment se priver de ces plaisirs terrestres devant l’absence des cieux ? Il ne s’agissait pas de se goinfrer, ils en étaient incapables. L’ingratitude de la vie les avait condamnés à une forme de misère. Celle-ci n’était pas dépourvue de grandeur et de panache, mais elle ne permettait que ce qu’elle était. Aussi, ils se contenteraient de dévorer les livres, de se saouler à l’encre noire, d’embrasser le métal de presse, de suer sur les écrits. Les belles charbonnades, les beaux jambons et les belles cabirotades, ils ne les mangeaient que dans les livres. La vie était autrement. Cela n’importait pas. L’essentiel pour eux c’était le monde des livres. Et ils étaient prêts à tous les sacrifices pour lui.